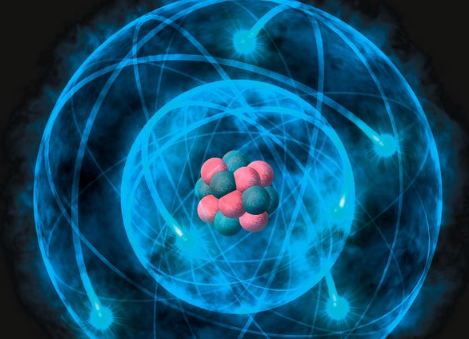AM1 : Structure électronique de l’atome
Apparu pendant l’antiquité, décrié jusqu’au 19ème siècle, le concept d’atome comme entité insécable finit par s’imposer au début de XXème siècle. En découvrant le noyau atomique en 1897, Rutherford permet l’essor du modèle planétaire Newtonien : un ensemble d’électrons gravitent autour du noyau comme des planètes autour d’une étoile. Ce modèle, adapté par Bohr pour interpréter le spectre d’émission de l’atome d’hydrogène, se montre finalement limité : il ne permet pas d’expliquer le spectre d’émission des atomes polyélectroniques.
La description de l’atome nécessite le développement d’une nouvelle théorie : la théorie quantique.
- Document de cours
- Pour comprendre en s’amusant : une petite BD
- Feuille d’exercices
- Est-ce que je connais mon cours? Faites ces quizz après avoir appris votre cours, avant une khôlle ou avant un DS
- Vidéo montrée en cours : le spin de l’électron
- L’électron dans tous ses états
- Les atomes
- Le spin
AM2 : La classification périodique des éléments
- Document de cours
- Pour comprendre en s’amusant : une petite BD
- Feuille d’exercices et correction
Sites spectres d’émission :
Ce site ouvre sur la classification périodique des éléments. En cliquant sur un élément son spectre d’émission s’affiche. Le menu à droite de l’écran permet de sélectionner le spectre de raie de l’atome ou de ses ions. Ce site est une animation Flash.
AM3 : Structure électronique des molécules
Une entité chimique moléculaire est un assemblage spécifique et unique d’atomes dans une disposition géométrique bien définie. On distingue les molécules, qui sont neutres, des ions polyatomiques, qui sont chargés. Les liens qui maintiennent les atomes dans cette disposition bien définie sont appelés liaisons chimiques. La nature de ces liaisons a été étudiée par Lewis (1875-1946, physicien et chimiste américain) en 1916 pour décrire la structure des entités chimiques moléculaires, description toujours utilisée aujourd’hui même si on connait ses limites. La simplicité de sa mise en œuvre permet d’obtenir très vite des informations concernant la géométrie et la réactivité des molécules.
- Document de cours
- Feuille d’exercices + Correction + Correction suite
- Récapitulatif : pour mieux retenir!
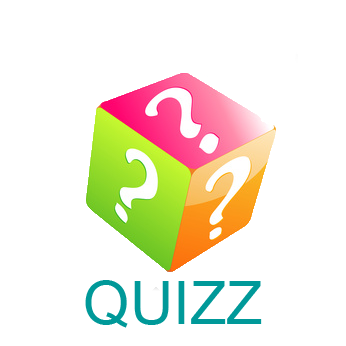
AM4 : Forces intermoléculaires et solvants
Il existe des interactions non covalentes (appelées aussi liaisons faibles) entre les entités chimiques qui constituent la matière. Plus ces interactions sont nombreuses et fortes, plus la cohésion de la matière est importante. Un système chimique peut présenter plusieurs types d’interactions non-covalentes simultanément.
L’analyse de ces interactions non covalentes au sein d’un système chimique permet d’expliquer, par exemple, les températures de changement d’état ou la solubilité des espèces dans un solvant.
Dissolution de NaCl : une approche dans la vidéo ci-dessous :